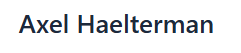Explications introductives
Il est temps d’apporter autant de clarté que possible aux projets de texte de loi relatifs à l’introduction de la taxation généralisée des plus-values. Dans la doctrine circulent plusieurs questions considérées à tort ou à raison comme ouvertes, mais, dans certains cas, elles reçoivent des réponses qui ne me paraissent pas correctes.
Au vu du contenu des textes et des informations de fond fournies dans l’exposé des motifs, il me semble probable que le Conseil d’État ne formulera pas d’observations insurmontables susceptibles de compromettre l’existence même de cette nouvelle taxe. Qui vivra verra.
J’aimerais attirer l’attention sur trois sujets, peut-être un peu plus techniques, mais qui peuvent réellement se poser dans un nombre significatif de dossiers.
Étant donné que chacun de ces sujets mérite son propre cadre et éclairage, je me limite à un sujet par Blog.
Apport d’un portefeuille d’actions dans une société simple
La société simple comme « evergreen »
Par coïncidence, mon ouvrage « Fiscale transparantie » a été publié en 1992, au moment où l’application de l’ancien article 250 du Code des impôts sur les revenus (actuellement l’article 344, §2 du CIR92) a été étendue aux sommes d’argent. Le transfert de sommes d’argent vers une holding luxembourgeoise exonérée d’impôts n’était dès lors plus opposable au fisc belge, sauf à apporter la preuve qu’aucune économie d’impôt n’était réalisée. Ce fut le coup fatal pour cette holding luxembourgeoise « Loi 1929 », utilisée jusqu’alors par des Belges fortunés (patrimoine à partir de ± 50 millions de BEF) et, de ce fait, l’essor de l’approche « société simple » développée dans mon ouvrage (thèse de doctorat).
Pourquoi ?
Cette approche permettait de loger un patrimoine privé dans une structure familiale simple, facilitant la donation à la génération suivante dans un cadre contrôlé, sans soumission à l’impôt des sociétés (fiscalement sous-optimal pour les portefeuilles d’investissement). L’absence de personnalité juridique de la société simple implique que les revenus restent soumis à l’impôt des personnes physiques, comme si les membres de la famille les percevaient directement. Il est néanmoins possible de « capitaliser » les rendements au sein d’un compte détenu par la société simple, sans mise à disposition individuelle.
Ajoutez à cela la possibilité de donation avec maintien du contrôle (et de l’usufruit) et l’idée d’un « club d’investissement familial » avec concertation périodique, où la génération suivante prend progressivement plus de décisions avec l’avancée en l’âge des parents…, et l’« evergreen » de l’organisation patrimoniale était né.
Dans de grandes banques, deux planificateurs en private banking très avisés ont saisi le concept lors d’un séminaire Biblo à l’Aula Maior d’Anvers, et le produit « société simple dans le cadre de la planification successorale » a vu le jour.
Des modifications législatives, des obligations comptables et la réglementation sur le registre UBO ont récemment suscité des questions au sein de certaines familles. L’idée d’une indivision pure, gérée par un « tiers » (les parents), de l’universalité d’un portefeuille d’investissement est depuis lors envisagée comme alternative. Cela n’a toutefois pas vraiment diminué l’attrait de la société civile, même si l’on utilise désormais plus volontiers des noms fantaisistes pour en limiter la traçabilité.
Il serait donc surprenant que la nouvelle taxation généralisée des plus-values vienne perturber la création d’une société civile par l’apport d’un portefeuille d’actions. Heureusement, comme vous le lirez plus loin, certaines alertes doctrinales récentes à ce sujet semblent infondées.
Non, l’apport d’un portefeuille d’actions dans une société civile ne déclenche pas l’application de la nouvelle taxe généralisée sur les plus-values.
Il convient, dans l’analyse des situations, de distinguer clairement ce qui relève du droit des biens et ce qui relève du droit des sociétés. Autrement dit, la présence d’un transfert (même partiel) de propriété — et donc d’une réalisation — est fondamentalement différente de la notion d’« apport ».
Petite comparaison
Un apport effectué par un associé participant (ou « occulte ») dans une société interne peut prendre la forme d’un transfert de propriété vers l’associé gérant (qui agit en son nom propre mais pour le compte de l’associé participant) ou simplement celle d’un droit d’usage (brevets, biens immobiliers). Dans ce dernier cas, il n’y a pas de transfert de propriété (pour les juristes anglo-saxons : éventuellement une « cession » de créances) mais bien un apport.
Transfert de propriété versus apport
Dans ma thèse sur la transparence fiscale, j’ai développé l’idée que l’apport d’un portefeuille d’actions dans une société civile peut donner lieu à plusieurs situations.
Cas 1
Des propriétaires indivis d’actions décident de s’organiser sous une forme sociétaire (sans personnalité juridique) et érigent leur indivision en un contrat de société : ils apportent le portefeuille à une société civile. Aucun transfert de propriété n’a lieu. L’indivision existante subsiste juridiquement. Elle reçoit une enveloppe sociétaire dès lors que les quatre éléments constitutifs du contrat de société sont réunis : pluralité de participants, mise à disposition « à risque », accords de gestion, intention de partager les rendements. Certains ajoutent l’« affectio societatis » que je considère comme une synthèse des quatre éléments précédents.
Par conséquent dans le cas 1 : pas de transfert de propriété mais bien un apport.
Cette situation se présente lorsque les parents donnent d’abord le portefeuille à la génération suivante, puis créent la société civile autour de celui-ci.
Cas 2
Le propriétaire du portefeuille l’apporte à une société civile, tandis que les autres participants apportent d’autres éléments (par exemple du cash). Le propriétaire passe alors d’une propriété exclusive à une propriété indivise avec les autres associés. Si le portefeuille vaut 50 et que les deux autres participants apportent chacun 25, ils obtiennent chacun 25 % de la propriété indivise du portefeuille, et le propriétaire initial échange sa pleine propriété contre 50 % du portefeuille et 50 % du cash[1].
Le propriétaire du portefeuille réalise donc la plus-value sur les 50 % qu’il apporte. Cela semble clair.
Divergences doctrinales
Certains commentateurs estiment que l’apporteur réalise 100 % de la plus-value, car il apporte l’ensemble du portefeuille. Ils fondent leur raisonnement sur le fait que, depuis les réformes du Code des sociétés, les sociétés sans personnalité juridique ont désormais un « patrimoine ». C’est exact, mais il faut bien comprendre ce que cela signifie : juridiquement, lesdites sociétés ne peuvent pas être propriétaires. Il n’y a donc pas de transfert vers la société civile, mais une redistribution entre les associés.
Le « patrimoine » est reconnu car les apports sont désormais soumis à des règles de gestion et de responsabilité nouvelles. Cependant cela n’a pas de conséquences juridiques autres que celles décrites dans les cas 1 et 2.
Et la taxe sur les plus-values ?
Ces considérations sont utiles mais n’ont pas d’impact direct sur la nouvelle taxe généralisée sur les plus-values quand il s’agit d’un apport d’actions.
Le projet de loi prévoit explicitement une exonération pour les « plus-values réalisées lors de l’apport d’actions ».
Quelle que soit la théorie adoptée — celle de la réalisation proportionnelle (que je considère correcte) ou celle de la réalisation totale (à éviter) — il n’y a pas de problème.
Un apport dans une société civile est bien un « apport », et ce pour l’ensemble du patrimoine apporté. Dans les deux cas, il y a apport du portefeuille entier, donc exonération.
Ouf.
Interprétation erronée
Certaines doctrines récentes affirment que l’exonération ne s’applique pas car il ne s’agit pas d’un apport à une société dotée de la personnalité juridique.
Toutefois cette lecture contredit le texte du projet. Celui-ci ne parle PAS d’« apport à une société » mais simplement d’« apport ». Si le texte avait repris les termes « à une société », le renvoi aurait pu être effectué vers l’article 2, §1, 5° CIR92, qui définit une société comme une entité ayant la personnalité juridique.
Il en résulte que l’exonération s’applique pleinement à l’apport d’actions dans une société civile[2].
Quid de la valeur d’acquisition ?
S’agissant des parts détenus par les associés
Si l’exonération s’applique, alors la règle est que les parts reçues en échange de l’apport reprennent la valeur d’acquisition des actions apportées.
Pour l’apporteur, cela signifie que les parts de la société civile qu’il reçoit ont une valeur d’acquisition égale à celle des actions initiales. Cela vaut pour l’ensemble du portefeuille, même si juridiquement le transfert de propriété ne concerne qu’une partie de celui-ci.
En pratique, cela pourrait être peu pertinent : les parts de sociétés civiles (familiales) ne sont presque jamais vendues à des tiers mais souvent transmises par donation. Et les règles fiscales en matière de donation sont connues.
Pour les autres associés, la situation est différente : ils n’ont pas apporté d’actions, mais acquièrent une part indivise. Leur valeur d’acquisition est donc la valeur réelle au jour de l’apport.
Et si la société civile vend ensuite les actions ?
Si la société vend les actions pour une valeur supérieure à celle de l’apport, la question devient plus pertinente.
La taxe sur les plus-values est intégrée à l’impôt des personnes physiques et doit être appliquée selon les règles normales de cet impôt. La plus-value réalisée est attribuée de manière transparente à chaque participant. Ceci constitue en fait la seule possibilité. La société civile n’a pas de « valeur d’acquisition » propre, car elle n’a jamais été propriétaire.
Pour l’apporteur (ou ses ayants droit), on regarde la valeur initiale (ou la « photo » au 31 décembre 2025).
Pour les autres, on prend la valeur au jour de l’apport (ou la « photo » au 31 décembre 2025).
Un exemple concret
Considérons les cas où A apporte des actions ayant une valeur d’acquisition dans son chef de 8.000, et dont la valeur le jour de l’apport est de 10.000. B apporte des obligations ayant une valeur d’acquisition dans son chef de 9.800, et un valeur le jour de l’apport de 10.000. A et B détiennent de ce fait donc chacun 50% de la société simple.
En effectuant l’apport A “réalise” la moitié des actions apportées, mais s’agissant d’un apport la plus-value est exonérée, et il maintient de valeur d’acquisition d’origine de 8.000.
B “réalise” la moitié des obligations en est donc soumis à la nouvelle taxe généralisée sur les plus-values sur un montant de (10.000 – 9.800) /2.
La vente ultérieure des actions détenues au niveau de la société simple pour un prix de 12.000 engendre l’application des règles de la transparence fiscale: 6.000 sont à faire valoir au niveau de B qui a obtenu sa part indivise des actions par la « réalisation » de la moitié de ses obligations. La valeur d’acquisition à prendre en considération dans son chef est 5.000, la plus-value taxable étant de 1.000.
Pour 6.000 la vente est à attribuer à A qui avait maintenu sa valeur d’acquisition initiale. La plus-value taxable dans son chef est de 2.000.
Partant de l’approche développée, il est facile de constater que « le compte est bon », et qu’il y a donc pas de déperdition fiscale. Supposons que la société simple vend également les obligations, et ceci pour un prix de 10.000. 5.000 revient à A (par le biais de l’application des règles de la transparence fiscale) qui réalise une plus-value de 1.000 car en raison de l’exonération de l’apport qu’il avait effectué sa part des obligations est censée lui avour « coutée » 4.000. 5.000 reviennent à B qui réalise une plus-value taxable de 100 car il s’agit de la part des obligations qu’il n’a pas « réalisé » lors de son apport. Eh bien donc: la valeur d’acquisition originale de l’ensemble était 17.800. Le prix de vente total en fin de parcours est 22.000. Soit un bénéfice global de 4.200. Et nous retrouvons comme base taxable: 100 auprès de B lors de l’apport des obligations; 100 auprès de B au moment de la vente des obligations; 1.000 auprès de B lors de la vente des actions ; 1.000 auprès de A lors de la vente des obligations ; 2.000 auprès de A lors de la vente des actions. En tout, exactement les 4.200 que nous devions retrouver!
De ce qui précède il découle que suivre la “route de la bière” afin d’éviter des droits de succession sans payer des droits de donation (situation en Flandres) ne permet pas d’échapper à la taxe sur les plus-values: suite à l’apport effectué par les parents sans émission de nouveaux parts de la société simple, les enfants voient accroître leur part dans le patrimoine de la société. Il s’agit d’une donation indirecte. En cas de transfert ultérieur des actifs détenus au niveau de la société simple la plus-value à attribuer aux associés est déterminée entièrement sur la base de la valeur d’acquisition originale de parents qui ont effectué l’apport. Il n’y a en effet pas eu “d’échange” avec un actif ayant une valeur supérieure. Il n’y a pas de step-up.
Autres actifs
Je n’aborde pas ici les cas d’apport de biens immobiliers dans une société civile. Ce ne sont pas des « actifs financiers » et ils ne relèvent donc pas de la nouvelle taxe sur les plus-values. D’ailleurs, pour la planification patrimoniale immobilière, on n’utilise pas la société civile.
D’autres actifs mobiliers peuvent être apportés à une société civile. Pour ceux-ci, l’analyse juridique ci-dessus s’applique, mais sans exonération explicite. Il peut donc y avoir un moment d’imposition (partiel). Ces actifs — souvent des titres à revenu fixe — peuvent être vendus plus facilement, avec réinvestissement lors de la création de la société civile, générant ainsi du cash pour payer la taxe. Les associés bénéficient alors d’un « step-up » en valeur, ce qui évite une double imposition, mais peut entraîner une imposition anticipée.
[1] S’agissant de la soi-disant “route de la bière” (schéma typiquement flamand ; dénomination horrible par ailleurs) cette approche est utilisée dans un mesure importante : la société simple est constituée par les parents et les enfants moyennant un contribution réduite par chacun. De ce fait les enfants obtiennent une part proportionnellement importante dans l’ensemble. Ensuite les parents apportent une valeur importante sans émission de nouvelles parts. De ce fait la valeur de la part détenue par les enfants dans l’ensemble accroît considérablement. Il s’agit d’une donation indirecte, visant à éviter les droits de donation. Mais impliquant des limitations importantes par rapport à l’utilisation d’un acte notarié classique.
[2] Dans l’antiquité fiscale, vous vous en souvenez, le “droit d’apport” (droit d’enregistrement ) de d’abord 1%, ensuite 0,5% et à partir de l’introduction du régime des intérêts notionnels réduit à 0%, était en principe également applicable en ce qui concerne des apports effectués dans des sociétés simples si ceux-ci engendraient l’obligation d’enregistrement (acte notarié) ou étaient enregistrés spontanément.