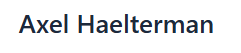Domaine d'activité : organisation patrimoniale et planification successorale
1. Généralités
Une planification patrimoniale bien conçue repose sur trois étapes successives :
- La détermination réfléchie des souhaits et objectifs de la personne concernée
- La traduction juridique (et donc la définition) de ces intentions
- L’évaluation fiscale des opérations et de la structure
Il est essentiel de respecter strictement cet ordre. Toute rétroaction, où le juridique ou le fiscal viendrait influencer les désirs personnels, est presque toujours à éviter. “Prime vivere, et deinde… penser aux impôts.”
Lors de la définition des souhaits et objectifs d’une personne fortunée, le rôle du conseiller juridique est, curieusement, d’une grande importance. L’expérience montre qu’il existe plusieurs types de situations auxquelles presque tous les dossiers individuels peuvent être confrontés, et que les personnes réfléchies partagent, à quelques nuances près, des schémas de souhaits étonnamment similaires. Les aspirations profondes des personnes sensées sont, en fin de compte… humaines.
L’accompagnement dans cette phase vise donc principalement à offrir des suggestions et des idées, non pas pour retirer la planification des mains de la personne concernée, mais pour lui faire bénéficier d’une sagesse issue de nombreuses générations au sein de familles fortunées. Il reste également essentiel de remettre en question de manière critique les désirs trop particuliers du planificateur. Si, par exemple, une personne souhaite une structuration contraignante qui lie irrévocablement les générations futures à un patrimoine ou à une entreprise, même si ces générations bien informées et unanimes souhaitent s’en détacher, il est probable que le planificateur emprunte une mauvaise voie.
Même s’il peut être souhaitable, dans le cadre d’un modèle de planification successorale, que le planificateur conserve un certain pouvoir de contrôle et veille, dans certaines circonstances, à ce qu’un schéma organisationnel connu de tous ne puisse être facilement renversé après son décès, l’instauration d’une “main morte” n’est que rarement l’objectif réel, ni une finalité appropriée.
⚖️ La planification patrimoniale est par excellence le domaine du droit descriptif.
Le conseiller juridique utilise sa connaissance des figures juridiques uniquement pour encadrer et interpréter juridiquement le résultat de la planification personnelle préalable. En d’autres termes, tel un “scriba”, le juriste consigne les souhaits et aspirations du planificateur patrimonial, et formalise les conditions, réserves et nuances exprimées.
Dans une seconde phase, en prenant du recul dans son fauteuil juridique, il évaluera quelle opération juridique ou structure découle de cette consignation. Le droit n’entrave pas : il rend les choses possibles, sûres et opposables. Le droit ne crée pas : il décrit, définit et complète là où la consignation ne permet pas de conclure.
Autrement dit, le juriste ne propose pas une société civile, une donation avec charge ou une réserve d’usufruit. Il consigne et constate ensuite, par exemple, que le souhait du planificateur de faire gérer ensemble la génération suivante, sous supervision, avec des revenus partiellement sur un compte commun et partiellement disponibles individuellement, avec des droits de sortie contrôlés, conduit en réalité à la création d’une forme de société civile.
Ce sont les souhaits du planificateur qui détermineront si cette société civile s’apparente davantage à une “indivision organisée” ou à une forme de propriété fiduciaire avec des participants silencieux dans une structure où la propriété est détenue par une ou quelques personnes.
💰 Reste bien entendu la dimension fiscale de toute planification patrimoniale.
Une bonne compréhension exige de reconnaître que l’évitement des droits de succession (au taux de 27%) est probablement déjà intégré dans la première phase, comme l’un des souhaits personnels du futur testateur.
Dans la mesure où les impôts sont une donnée économique externe, qui peuvent faire en sorte qu’il ne reste que peu de patrimoine à planifier, leur évitement devient l’un des premiers objectifs du planificateur patrimonial — en particulier dans un contexte familial simple, avec une entente complète et harmonieuse.
💼 La dimension fiscale de la planification patrimoniale
La dimension fiscale reste bien entendu un élément essentiel de toute planification patrimoniale. Une bonne compréhension suppose de reconnaître que l’évitement des droits de succession (au taux de 27 %) est souvent déjà intégré dans la première phase, comme l’un des souhaits personnels du futur testateur. Dans la mesure où les impôts constituent une donnée économique externe susceptible de réduire considérablement le patrimoine disponible pour une planification ultérieure, leur évitement devient l’un des premiers objectifs du planificateur patrimonial, surtout dans un contexte familial simple et harmonieux.
⚖️ Fiscalité de la transmission vs. fiscalité de l’organisation patrimoniale
Aujourd’hui, on observe une distinction marquée entre la fiscalité de la transmission patrimoniale (droits de succession/droits de donation) et celle de l’organisation patrimoniale (impôts sur le revenu).
Concernant la transmission, les prélèvements principalement régionalisés ont évolué depuis vingt ans d’un régime fortement pénalisant vers un système plus raisonnable et abordable pour les transmissions en ligne directe. Autrefois, de nombreux Belges se sentaient “contraints” d’abuser de l’anonymat de leur patrimoine pour effectuer des transmissions officieuses, entraînant une fraude fiscale étendue : impossibilité de réinvestir les actifs non déclarés, indisponibilité de ces actifs pendant des années (délai de prescription), risques de chantage par des tiers ou des branches familiales non bénéficiaires, etc.
Aujourd’hui, la transmission de patrimoines importants est réalisable à un taux de 3 % (et même 0 % pour les biens professionnels et les actions de sociétés familiales), tandis que les éléments résiduels peuvent être transmis à 9 % (avec étalement dans le temps), le tout avec des garanties pour le testateur. Les instruments de base sont bien connus : donations mobilières devant notaire belge à 3 % sans période d’incertitude (la possibilité de donation sans droits via notaire étranger a été supprimée le 15 décembre 2020), dons manuels ou bancaires (ou autres formes de donation indirecte) avec une incertitude de cinq ans, éventuellement couverte par une assurance temporaire décès ; taux de 0 % pour les donations de sociétés familiales ; application distincte des taux sur les biens mobiliers et immobiliers pour éviter d’atteindre le taux de 27 % en ligne directe (uniquement en Flandre) ; et diverses constructions pour la transmission de patrimoines importants, à condition qu’elles soient envisagées et mises en œuvre en temps utile.
Fiscalité des revenus et détention du patrimoine
C’est dans le domaine de l’impôt sur le revenu et de la fiscalité liée à la détention du patrimoine que l’on observe une tendance à l’alourdissement. Cela semble inévitable : les exigences budgétaires et le vieillissement de la population poussent le gouvernement fédéral dans cette direction.
Il faut d’abord constater que le gouvernement fédéral n’a pas réussi à constituer une réserve budgétaire durant les années favorables, en vue du vieillissement démographique. Au contraire, plusieurs taxes liées à l’environnement, à la consommation de luxe, à l’énergie ont été testées dès 2003–2005. Or, ce sont précisément ces instruments qu’il aurait été préférable de conserver pour une réforme fiscale équilibrée dans une société vieillissante.
Avec une baisse du taux d’activité (proportionnellement à la population totale), il faut rechercher des prélèvements qui ne pèsent pas uniquement sur le groupe actif professionnel, mais aussi sur les personnes inactives disposant d’une capacité contributive. Le mode de vie et les habitudes de consommation peuvent en être les indicateurs. Voilà une piste de réflexion pour une fiscalité adaptée au vieillissement, à utiliser toutefois avec modération. Les achats en ligne ou les déplacements vers Lille ou Breda permettent d’échapper à ce type de fiscalité, sauf si celle-ci vise la détention de certains actifs — un critère difficile à contrôler en pratique.
🏛️ Répartition des compétences fiscales
La nécessaire redéfinition des compétences fiscales entre les régions et le gouvernement fédéral — en cours et à poursuivre (sauf changement majeur en Wallonie) — risque également d’accélérer l’alourdissement des impôts fédéraux sur le patrimoine et les revenus patrimoniaux.
Les régions (principalement la Flandre) souhaitent exercer leurs compétences économiques et en matière d’emploi (ainsi que dans une certaine mesure en matière de logement, culture et enseignement) autrement que par le biais de subventions. L’impôt sur le revenu est, avec la politique de subvention, le second instrument économique fondamental. Il est donc logique que cet outil soit entre les mains de l’autorité compétente en matière de politique économique.
Dans cette redistribution, il est probable que le gouvernement fédéral conserve l’impôt sur les revenus patrimoniaux, en plus d’une part suffisante dans l’impôt des sociétés et l’impôt sur les revenus professionnels. Il approfondira donc cette branche de la fiscalité, notamment parce qu’elle pose moins de problèmes de concurrence fiscale intra-européenne.
Les signes sont clairs : augmentation du précompte mobilier à 30 %, introduction d’un impôt désormais conforme à la Constitution sur les comptes-titres, durcissement de la taxe “Cayman”, forte hausse de la taxe patrimoniale sur les entités non lucratives.
📅 Nouvel impôt sur les plus-values privées
L’impôt général de 10 % sur les plus-values privées réalisées sur actifs financiers, en vigueur à partir du 1er janvier 2026, est la manifestation la plus récente de cette évolution. Son introduction suscite de nombreuses critiques et soulève des questions, notamment sur la détermination de la “valeur de départ” (valeur réelle des actifs au 1er janvier 2026) pour éviter une taxation sur des plus-values passées, ainsi que sur les formalités et obligations des banques, la combinaison avec la “taxe Reynders” sur les fonds obligataires, etc.
Il semble que cette taxe ait été le “sacrifice nécessaire” pour rendre politiquement et socialement acceptables d’autres réformes socio-économiques majeures, telles que la réforme des pensions ou la limitation dans le temps des allocations de chômage.
🌍 Tendances récentes en Flandre
À l’échelle flamande, deux tendances se dessinent :
- D’une part, rien n’indique une volonté de remettre en cause les possibilités existantes d’organisation successorale. Les techniques favorables à la “saut de génération” — où, en raison de l’évolution de l’espérance de vie, le patrimoine passe de plus en plus des grands-parents aux petits-enfants — en sont un bon exemple.
- D’autre part, une exigence croissante vise à exclure les planifications jugées trop artificielles. On en trouve des exemples dans la politique de Vlabel, mais aussi dans les récentes adaptations décrétales flamandes : prolongation du délai de 3 à 5 ans pour les donations sans droits, conditions formelles plus strictes pour l’efficacité des “legs en duo”, etc.
Répartition des compétences fiscales
La nécessaire redéfinition des compétences fiscales entre les régions et le gouvernement fédéral — en cours et à poursuivre (sauf changement majeur en Wallonie) — risque également d’accélérer l’alourdissement des impôts fédéraux sur le patrimoine et les revenus patrimoniaux.
Les régions (principalement la Flandre) souhaitent exercer leurs compétences économiques et en matière d’emploi (ainsi que dans une certaine mesure en matière de logement, culture et enseignement) autrement que par le biais de subventions. L’impôt sur le revenu est, avec la politique de subvention, le second instrument économique fondamental. Il est donc logique que cet outil soit entre les mains de l’autorité compétente en matière de politique économique.
Dans cette redistribution, il est probable que le gouvernement fédéral conserve l’impôt sur les revenus patrimoniaux, en plus d’une part suffisante dans l’impôt des sociétés et l’impôt sur les revenus professionnels. Il approfondira donc cette branche de la fiscalité, notamment parce qu’elle pose moins de problèmes de concurrence fiscale intra-européenne.
Les signes sont clairs : augmentation du précompte mobilier à 30 %, introduction d’un impôt désormais conforme à la Constitution sur les comptes-titres, durcissement de la taxe “Cayman”, forte hausse de la taxe patrimoniale sur les entités non lucratives.
📅 Nouvel impôt sur les plus-values privées
L’impôt général de 10 % sur les plus-values privées réalisées sur actifs financiers, en vigueur à partir du 1er janvier 2026, est la manifestation la plus récente de cette évolution. Son introduction suscite de nombreuses critiques et soulève des questions, notamment sur la détermination de la “valeur de départ” (valeur réelle des actifs au 1er janvier 2026) pour éviter une taxation sur des plus-values passées, ainsi que sur les formalités et obligations des banques, la combinaison avec la “taxe Reynders” sur les fonds obligataires, etc.
Il semble que cette taxe ait été le “sacrifice nécessaire” pour rendre politiquement et socialement acceptables d’autres réformes socio-économiques majeures, telles que la réforme des pensions ou la limitation dans le temps des allocations de chômage.
2. Techniques à utiliser
2.1. Société versus détention privée
La toute première question qui se pose est de savoir si le patrimoine doit être détenu en tant que personne physique ou via une forme sociétaire dotée de la personnalité juridique.
Il convient de noter que l’utilisation de la société civile, en tant que forme sociétaire sans personnalité juridique, vise précisément à combiner l’organisation du patrimoine et le contrôle via une structure sociétaire, tout en maintenant l’application de l’impôt des personnes physiques.
En ce qui concerne la réalisation d’investissements mobiliers diversifiés, l’utilisation d’une société dotée de la personnalité juridique est fiscalement sous-optimale. Pour la détention de biens immobiliers, la stratégie optimale dépend de plusieurs critères à prendre en considération :
- Immobilier résidentiel versus commercial
- Immobilier récent versus ancien
- Vente prévue ou non
- Importance de la planification successorale
- Usage personnel ou non
2.2. Planification en matière de droits de succession
Toute planification successorale combine trois éléments ou aspects successifs :
- Un transfert définitif du patrimoine à la génération suivante afin que la masse successorale soit minimale au moment du décès
- Un modèle organisationnel garantissant à la génération cédante un flux de revenus et un montant de ressources suffisant pour vivre sereinement
- Une organisation appropriée du contrôle sur le patrimoine, en fonction de la nature des biens et de l’âge et des caractéristiques de la première et de la génération suivante
Pour une explication détaillée, voir :
Axel HAELTERMAN, Vermogensplanning – Een referentiekader (Planification patrimoniale – Un cadre de référence), Die Keure, 2025, 95 pages