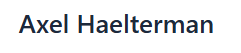L’article 35 de la loi-programme du 18 juillet 2025 prévoit que désormais, pour les sociétés, l’application de la déduction RDT sur les dividendes reçus (et donc aussi l’exonération des plus-values) est soumise à la condition que la participation atteigne au moins 10 %, ou qu’elle ait une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros et qu’elle ait, dans ce cas, la nature d’un actif immobilisé financier.
Cette condition supplémentaire ne s’applique pas aux “petites sociétés”, ce qui, en pratique, aura rarement un impact réel Plutôt rares sont en effet les “petites sociétés” qui détiennent plus de 2,5 millions d’euros dans une seule action à titre de placement de trésorerie…
Malgré quelques remarques à ce sujet, y compris dans l’avis du Conseil d’État, il ne fait selon moi aucun doute que cet ajout n’est pas contraire à la directive mère-fille, car il s’agit d’une condition ajoutée à une possibilité d’exonération qui n’est pas prévue par ladite directive.
La logique conceptuelle derrière cet ajout est claire : il s’agit de mieux distinguer les actions détenues comme placement de trésorerie, avec imposition complète des dividendes et plus-values, des actions constituant une participation, avec exonération des dividendes et plus-values. Du point de vue législatif, on aurait pu s’attendre à ce que la condition d’“actif immobilisé financier” remplace simplement le seuil de 2,5 millions d’euros comme second critère d’exonération, mais cette idée n’a finalement pas été retenue.
Quand une participation a-t-elle la nature d’un “actif immobilisé financier” ?
À mon étonnement, certains commentateurs, y compris des personnes très compétentes travaillant au sein des cabinets Big Four, ont suggéré que l’introduction de cette exigence engendre une grande incertitude fiscale et soulève de nombreuses questions. Pourtant, il s’agit d’un concept qui est appliqué de manière relativement cohérente depuis des dizaines d’années dans la pratique comptable quotidienne. Ce n’est pas parce que ce concept est désormais lié à un avantage fiscal qu’il deviendrait de ce fait soudainement flou ou incertain.
Une chose est cependant très claire : il ne suffit PAS de comptabiliser une participation à l’actif du bilan comme “actif immobilisé financier” pour pouvoir prétendre à l’exonération (dans les cas où le seuil de 2,5 millions d’euros soit atteint). L’enregistrement comptable à lui seul n’est pas constitutif d’un actif immobilisé financier. L’exonération ne peut être revendiquée que si la participation a réellement la nature d’un actif immobilisé financier. On pourrait même dire qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit comptabilisée comme telle… bien que dans ce cas le débat risque de devenir moins évident en pratique.
En d’autres termes, l’administration fiscale n’est liée que si la participation est enregistrée correctement et pour des raisons appropriées comme actif immobilisé financier.
La législation fiscale ne définit pas ce qu’est un “actif immobilisé financier”, ce qui est logique : il s’agit d’un concept relevant du droit comptable. Les normes IFRS 9 et IAS 32 parlent de “financial assets”, mais la définition concrète se trouve dans la réglementation belge : plus récemment dans l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (CSA), et auparavant dans l’ancien AR du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises. Le concept apparaît également dans le Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN) et dans les avis de la Commission des Normes Comptables (CNC).
En résumé, pour toute participation inférieure à 10 % (au-delà de ce seuil, il s’agit automatiquement d’une “participation” et donc d’un actif immobilisé financier), il faut pouvoir démontrer qu’il existe un lien durable et spécifique avec la société dont les actions sont détenues. Ce lien doit contribuer à l’activité propre de la société détentrice. Il est donc essentiel que la détention des actions vise à soutenir durablement l’activité de la société, ou qu’elle soit détenue dans le cadre ou dans le prolongement de cette activité. Un simple “investissement externe” dans une société tierce ne suffit pas.
Ainsi, une participation ne constitue pas un actif immobilisé financier si elle est acquise pour placer des liquidités accumulées dans la société, sans que la détention d’actions qui en découle n’ai un lien quelconque avec son activité propre. Par exemple, si une société de management active dans divers conseils d’administration achète pour au moins 2,5 millions d’euros d’actions AB InBev, cela ne constitue pas un actif immobilisé financier. Il semble que la conversion de liquidités ou d’autres placements en une position, même significative, en actions dans le seul but d’obtenir un rendement, ne mènera probablement pas à une qualification d’actif immobilisé financier pour une société active “normale”.
Cas concrets d’actif immobilisé financier
Dans quels cas concrets une participation de moins de 10 % (donc une petite participation sans influence significative), mais avec une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros, peut-elle avoir la nature d’un actif immobilisé financier ?
Un exemple typique est celui d’un producteur qui acquiert une participation minoritaire dans un distributeur de ses produits, souvent comme soutien financier. Ou encore une entreprise de construction qui acquiert des actions dans une société de charpenterie avec laquelle elle collabore fréquemment. Les exemples concrets peuvent être très variés, mais dans tous les cas, la participation est clairement détenue dans le prolongement de l’activité propre. Le fait que l’acquisition ait été financée par des liquidités précédemment comptabilisées comme placements financiers n’a alors aucune importance.
Un autre exemple très concret concerne une société de management qui acquiert et détient une participation dans une des sociétés où elle siège elle-même comme administrateur, via son représentant permanent. Là aussi, la participation semble clairement avoir la nature d’un actif immobilisé financier.
En bref, une appréciation des faits s’impose effectivement, mais elle ne mène pas, selon moi, à une incertitude excessive si les lignes directrices exposées ci-dessus sont appliquées de manière raisonnable. Ou encore : une version informée du “I know it when I see it”, dans un cadre bien connu.
Le fardeau de la preuve
Enfin, qui doit prouver quoi en premier lieu ? Si une participation est comptabilisée comme actif immobilisé financier, la déduction RDT ou la “majoration de la situation de début des réserves” en vue de l’exonération d’une plus-value réalisée, sera naturellement revendiquée dans la déclaration à l’impôt des sociétés. Il revient alors à l’administration fiscale d’agir et, le cas échéant, de mettre en question l’application de la déduction ou de l’exonération. Dans ce cas, étant donné que celui qui revendique une exonération ou une déduction est en principe tenu d’en démontrer l’applicabilité, l’administration fiscale peut se contenter d’une demande d’informations, posant la question de savoir quels éléments concrets établissent le lien durable et spécifique, et donc la nature d’actif immobilisé financier. La charge de la preuve repose ainsi très rapidement sur la société elle-même.